TRAITEMENT CONTRE LES TERMITES
SOUTERRAINS SELON LA NORME NF X 40-501
3.4. TRAITEMENT CONTRE LES TERMITES SOUTERRAINS
Selon les variétés de termites, leur mode de vie et leur processus d'attaque de la cellulose et
compte tenu de la grande diversité des constructions, la réalisation d'un traitement s'avère très
complexe. II nécessite des connaissances essentielles sur la biologie des termites, sur le bâti
ancien et les régles de la construction.
Le diagnostic « termites» développé au chapitre 2 est déterminant pour concevoir le traite-
ment.
3.4. 1. TRAITENIENT CURATIF
I1 est difficile de parler actuellement de traitement «curatif» pour les termites. En effet,
compte tenu des techniques et des produits utilisés, l'objectif est de protéger la construction et
non d'éradiquer les termites. Ainsi, lorsqu'un bâtiment est traité, les termites sont « repoussés»
à l'extérieur, voire chez le voisin ! Il faut en être conscient afin d'envisager les conséquences
d'une intervention partielle sur un bâtiment, où les parties non traitées seront inéluctablement
plus vulnérables.
Par ailleurs, la protection d'une construction contre les termites est fonction des conditions
d'hygiène et de salubrité régnant dans le bâtiment et ses alentours. Le fascicule de documentation
NF X 40-501 « Protection des constructions contre tes termites en France » fournit
quelques mesures complémentaires à prendre.
Les principaux conseils à donner avant toute intervention visent à supprimer toute cause d'humidité, à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment :
· Supprimer les infiltrations d'eau, notamment par le contrôle de l'étanchéité des fenêtres, des
raccords de canalisations, etc...
· Surveiller les phénomènes de condensation.
· Limiter, voire supprimer, les remontées capillaires d'eau dans les murs.
· Assurer une bonne ventilation des caves, sous-sols, vides sanitaires et de tous les locaux
humides.
· Vérifier l’état de la toiture, des chenaux, des descentes d'eau, des conduites d'évacuation,
des regards, etc.
· Supprimer les points d'eau stagnante à proximité de la construction.
· Limiter la végétation trop proche des murs (plantes grimpantes, arbustes, etc.).
· Éliminer du terrain les vieux bois morts, les souches, etc.
· Isoler les stocks de bois de chauffage du sol et de la construction.
Ces mesures ne sont pas, en général, du ressort de l'applicateur de traitement, mais celui-ci
peut attirer l'attention du propriétaire sur ces précautions fondamentales. Dans l'hypothèse où
aucune mesure n'est prise par le client, l'entreprise peut formuler des réserves de garantie pour
éliminer toute ambiguïté en cas de récidive d'attaque des termites.
La règle de base à respecter pour concevoir un traitement efficace consiste donc à définir un
périmètre d'intervention, aussi bien sur l'implantation de la construction que sur son élévation.
Le principe est de prévoir une intervention sur toute une tranche de bâtiment, du rez-de-chaussée jusqu'aux niveaux supérieurs. En effet, compte tenu du mode d'infestation des termites le plus courant, du sol en remontant vers le haut de la construction, on ne peut concevoir une intervention sans prendre en compte les locaux inférieurs.
Une opération par tranche a pour but de ceinturer la construction sur son périmètre de base, en
répétant ces ceintures sur chaque niveau, afin d'isoler ]es parties traitées des parties attenantes
ou mitoyennes. Ces ceintures de traitement visent les parties suivantes :
□ les sol intérieurs et extérieurs,
□ les murs de soutènement, soubassements et élévations,
□ les cloisons,
□ les doublages,
□ les bois.
Le traitement des sols extérieurs
Le sol extérieur au bâtiment doit être traité de façon continue sur tout son périmètre, excepté
dans le cas de mitoyenneté, selon un des deux procédés suivants, choisi par l'applicateur en
fonction de la nature du sol et des possibilités.
1er procédé : traitement des sols extérieurs par forage et infiltration, communément appelé barrière d'injections au sol.
Les forages et infiltrations peuvent être effectués au moyen d'un pal injecteur. Les perçages
sont suivis du remplissage avec un produit insecticide approprié, par gravité ou sous pression,
ou par tout autre moyen équivalent (voir les produits de traitement au chapitre 4).
Les percements verticaux ou en biais vers le mur de fondation, ou parallèlement à ce dernier,
doivent être effectués le plus près possible des murs. Comme indiqué sur la figure suivante, la
distance « b » entre ces percements et le mur ne doit pas excéder 0,40 m. La profondeur mini-
male « a » de chaque puits d'injection doit être de 0,40 m.
Les percements sur une ou plusieurs lignes parallèles au mur sont pratiqués de manière à ce
que deux trous voisins ne soient pas distants de plus de 0,20 m. Dans le cas de percements sur
plusieurs lignes parallèles, ceux-ci doivent être disposés en quinconce (figure 3.4.).

- Figure 3.4 –
2éme procédé : traitement des sols extérieurs par creusement d'une tranchée
Une tranchée parallèle au mur est creusée sur le pourtour du bâtiment sur une profondeur minimale de 0,40 m. La distance maximale entre la paroi verticale de la tranchée la plus proche du mur et le mur lui-même, notée « a » sur la figure 3.5. est de 0,40 m (figure 3.5.).
Le traitement est alors effectué par épandage d'un produit insecticide approprié le long des parois et au fond de la tranchée. Un produit de type similaire doit être mélangé à la terre de remblai.
Des injections complémentaires dans le fond de la tranchée peuvent être effectuées pour une
meilleure protection, dans certains cas particuliers.
Nota : Dans le cas où le traitement de sol ne pourrait être fait dans la zone périmétrique du bâtiment (trottoir côté rue en zone urbaine), cette barrière sera effectuée dans le mur à l'angle
sol/mur, et ne remplace aucunement la barrière « mur » décrite plus loin (voir « Traitement des murs »).

- Figure 3.5 -
Le traitement des sols intérieurs
Le traitement des sols intérieurs situés dans des caves, sous-sols, vides sanitaires, ou rez-de
chaussée sur terre-plein, sera adapté à leur nature.
On distinguera essentiellement deux cas :
Les sols maçonnés
Le traitement des sols maçonnés intérieurs doit être réalisé par le premier procédé cité précédemment, c'est-à-dire la barrière d'injections au sol, à l'aplomb des murs périphériques de la construction.
La profondeur minimale des puits doit être de 0,40 m, sachant que les forages doivent, dans
tous les cas, traverser l'épaisseur maçonnée. Dans le cas où le sol présente des joints de dilatation ou des fissures, les injections se font dans ceux-ci.
Cependant, si le degré d'infestation du site l'impose, le traitement doit être exécuté par un
écran sur le sol. L'écran consiste à effectuer, sur toute la surface du sol, des injections disposées selon des lignes fictives parallèles entre elles, et espacées de 50 cm maximum. La profondeur minimale est de 40 cm.
Les sols de terre battue
En fonction du degré d'infestation et de l'utilisation faite du sol, on choisit soit l'épandage de
produit, soit l'écran d'injections (vu précédemment) sur toute la surface du sol.
Lorsqu'un plancher bois avec parquet repose sur le sol (ou sur remblai), ce dernier est traité par application abondante de produit au travers d'un quadrillage de trous forés au travers du parquet, entre les lambourdes (le traitement du plancher bois est abordé plus loin).
Le traitement des murs
Les deux principaux procédés utilisés sont :
La barrière antitermites
I1 s'agit d'un traitement par injections effectué le plus près possible du sol, le long d'une ligne
parallèle à celui-ci. Les injections se font tous les 20 cm maximum. La profondeur des puits
doit être égale aux deux tiers de l'épaisseur du mur. Si cette épaisseur est supérieure à 60 cm, et si les moyens de percement ne permettent pas d'atteindre les deux tiers, les percements sont
exécutés des deux côtés du mur jusqu'à la moitié de l'épaisseur.
L'écran antitermites
Cet écran est utilisé dans le cas où il y a un risque d'infestation de la totalité du mur, ou lors-
qu'il n'y a pas d'accès sur l'autre face (cas des murs de soutènement).
Ce traitement se fait par des percements sur des lignes parallèles horizontales, espacées de
50 cm. Ils sont répartis en quinconce, tous les 50 cm. Leur profondeur doit traverser les deux
tiers de l'épaisseur du mur.
I1 faut cependant adapter ces procédés en fonction des matériaux rencontrés :
Cas des moellons
La profondeur des injections, d'au moins les 2/3 de l'épaisseur du mur, doit en outre dépasser
le parement et atteindre le « rembourrage » du mur (figure 3.6.).

Figure3.6
Cas des pierres appareillées et parpaings pleins
Les injections doivent être faites dans les joints.
Cas des briques pleines et torchis
Les injections doivent être faites comme dans le cas général de la barrière antitermites.
Cas des briques creuses et parpaings creux
Ils doivent être traités par barrière d'injections, de manière à imprégner au maximum le matériau constitutif dans l'épaisseur du mur. Les fissures éventuelles doivent être particulièrement bien repérées et traitées.
Le traitement des murs comprend :
- les murs périmétriques,
- les murs de refend,
- les murs mitoyens,
- les caves voutées.
Les murs périmétriques (y compris les murs de soubassement et les murs de soutènement)
Ils doivent être traités aux niveaux sous-sol/cave et rez-de-chaussée de sorte que les barrières
d'injections ceinturent la construction de façon continue.
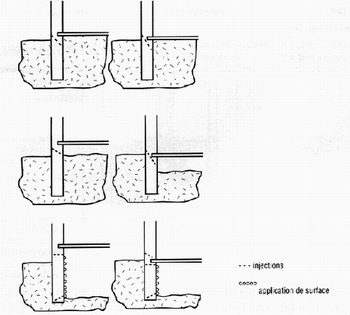
Figure 3.7-
Les principaux cas de figure, quelles que soient les régions termitées, apparaissent dans les
schémas suivants, sachant que le traitement indiqué est un minimum indispensable. En effet,
lorsque le degré d'attaque est important, des barrières d'injections supplémentaires peuvent
être réalisées, tout comme des écrans d'injections (figure 3.7.).
Les murs de refend (sur fondations)
Ils sont systématiquement traités à leur base au moyen de la barrière antitermites, aux niveaux
sous-sol et rez-de-chaussée.
Les murs mitoyens
Selon le degré d'attaque connu dans les bâtiments voisins, la barrière horizontale d'injections
dans le mur mitoyen au sous-sol et rez-de-chaussée est aussi réalisée dans le mur, au niveau de chaque plancher de mitoyenneté.
Par ailleurs, une barrière verticale d'injections jusqu'à 1,50 m de hauteur environ, doit être réalisée à la séparation avec des constructions mitoyennes, ainsi qu'aux angles formés avec les
murs attenants.
Les caves voûtées
Le traitement de ces caves comprend à la fois :
□~ une barrière basse continue (au-dessus du sol),
□~ une barrière haute continue (au-dessous de la voûte),
□~ soit un traitement du plancher supérieur par quadrillage d'injections (écran), soit un
quadrillage d'injections par en dessous dans la voûte (en s'assurant auparavant des risques
structurels encourus).
Le traitement des cloisons
Lorsque la cloison repose sur un plancher ou sur une lisse basse, il n'est pas indispensable de la traiter par injections. En revanche, si celle-ci repose sur le sol, il est nécessaire de réaliser une barrière d'injections telle qu'elle est décrite précédemment.
Le traitement des doublages (contre-cloisons, etc.)
Tous les doublages des niveaux infestés doivent être traités de préférence en partie haute, par
une ligne d'injections atteignant la lame d'air entre le doublage et le mur (ou entre le doublage
et la cloison). Lorsque l'injection risque de dégrader l'isolant sous doublage, le traitement peut
être réalisé en partie basse.
De plus, lorsque le mur lui-même est traité à sa base par une barrière antitermites au travers du doublage, les injections sont faites en deux temps : tout d'abord dans l'épaisseur du mur, puis dans le vide derrière le doublage.
Le traitement des bois
Ces traitements concernent :
- les planchers,
- les charpentes,
- les linteaux et les raidisseurs de cloisons,
- les huisseries de portes,
- les dormants de fenêtres,
- Les plinthes,
- les lambris et boiseries.
Les planchers
Le traitement des planchers s'impose à tous les niveaux infestés, ainsi qu'au niveau supérieur
où aucune attaque n'a été décelée (ce qui signifie que le diagnostic porte sur l'ensemble des
niveaux). Ce niveau supérieur non infesté n'est traité qu'aux encastrements des éléments de
portée. Ceux-ci englobent toute pièce de bois prenant appui directement sur les maçonneries en un ou deux appuis, ou indirectement sur une pièce de bois y prenant appui à son tour (cas des solives, solives de rive, poutres, solivettes).
Les encastrements sont alors traités par deux injections : l'une au travers de I'encastrement et
débouchant dans le contact bois/maçonnerie, l'autre « plein bois » à l'aplomb du mur (figure 3.8.).

- Figure 3.8.
Cas des solives accessibles
Dans le cas d'éléments de portée difficilement accessibles par le dessus, les injections peu-
vent être faites à l'aplomb du mur, dans la maçonnerie, atteignant au-dessous l'encastrement
dissimulé.
Le traitement des éléments de charpente (sablières, pannes, chevrons, entraits) et le solivage de charpente sera abordé ultérieurement.
Deux configurations de planchers sont envisagées :
Cas des planchers sur sol ou u moins de 0,40 m du sol
Le traitement consiste en :
□ une application de surface sur les éléments de portée, généralement réalisée au travers du
parquet par un quadrillage de trous entre les solives sur tout le plancher ;
□ des injections tous les 33 cm dans tous les éléments de portée du plancher sur toute leur
longueur;
□ deux injections dans tous les encastrements de ces éléments de portée (l'une « plein bois » à
l'aplomb du mur et l'autre dans la liaison mur/bois) ;
□ dans le cas de parquet, l'épandage sur les lames préalablement mises à nu.
Cas des planchers à plus de 0,40 m du sol, les planchers bus des étages infestés, et le plancher bas du niveau supérieur non infesté
Le traitement consiste en :
□ une application de surface sur les éléments de portée une fois mis à nu dans le cas de poutres apparentes, ou au travers du parquet par un quadrillage de trous entre solives sur tout le plancher;
□ deux injections dans tous les encastrements de ces éléments de portée (l'une « plein bois » et l'autre dans la liaison mur/bois) ;
□ pour les éléments en contact avec les maçonneries, comme les solives de rive, des injections
tous ]es 33 cm sur toute leur longueur ;
□ pour les éléments de portée dans lesquels on a pu déceler une attaque, des injections tous les
33 cm sur toute leur longueur ;
□ dans le cas de parquet, l'épandage sur les lames préalablement mises à nu.
Les charpentes
Si la présence de termites n'est pas décelée dans la charpente, celle-ci doit malgré tout être traitée lorsque le niveau inférieur de la construction est infesté.
Le traitement comprend alors :
□ des injections tous les 33 cm, sur tous les éléments au contact de la maçonnerie, tels que les
solives de rive, les sablières, les chevrons de rive, et ceci sur toute leur longueur ;
□ deux injections dans tous les encastrements de bois dans la maçonnerie, l'une « plein bois »
a l'aplomb du mur. l'autre dans la liaison mur/bois (encastrements de solives, entraits, pannes, chevrons) ;
□ une injection à la base de chaque chevron ;
□ L'application de surface sur tous les éléments au contact de la maçonnerie, tels que les solives de rive, les sablières, les chevrons de rive ;
□ L'application de surface des 50 premiers centimètres des éléments de charpente en appui sur
la maçonnerie tels que solives, entraits, pannes, chevrons.
Si la charpente présente des traces d'attaque de termites, elle doit être traitée comme précédemment, avec en supplément les opérations qui constituent le traitement contre le capricorne, l'hespérophanes, les petite et grosse vrillettes, à l'exception du bûchage et du brossage. Cela comprend donc le sondage, le dépoussiérage, le traitement en profondeur et l'application de surface.
Compte tenu des dégradations que peuvent occasionner les termites, le bûchage n'est pas réalisable, mais il est d'autant plus nécessaire d'évaluer par sondage la résistance mécanique des pièces attaquées en vue de les renforcer, voire de les remplacer.
Les linteaux
Aux niveaux infestés de la construction, les linteaux sont traités en totalité à la fois par des
injections « plein bois » et par des injections débouchant dans le contact bois/maçonnerie.
Les raidisseurs de cloisons
Aux niveaux infestés, les raidisseurs de cloisons sont traités en totalité par des injections
« plein bois ».
Les huisseries de portes
À chaque niveau infesté, toutes les huisseries, dans les murs comme dans les cloisons, sont traitées :
□ dans chaque montant avec :
- une injection basse « plein bois »,
- une injection à mi-hauteur « plein bois »,
- une injection haute débouchant sur la maçonnerie ;
□ dans la traverse haute avec une injection « plein bois » à chaque extrémité.
Les dormants de fenêtres
Le traitement comprend :
□ trois injections dans la pièce d'appui jusqu'au contact bois/maçonnerie,
□ trois injections dans les montants comme pour les huisseries de portes,
□ deux injections « plein bois » en traverse haute comme pour les huisseries de portes.
Les plinthes
La face cachée des plinthes en contact avec la maçonnerie doit être traitée selon l'un des trois
procédés suivants :
□ l'introduction de produit à travers la plinthe par percements atteignant la maçonnerie, ceci
tous les 33 cm maximum ;
□ la pulvérisation des faces visibles, en insistant aux endroits où des décollements du mur
peuvent apparaître. Ce type de traitement n'est possible que si le produit est absorbé par le
bois dans les quantités minimales imposées par les prescriptions techniques pour les
traitements contre les autres insectes xylophages (absence de peinture ou de vernis étanche
au produit) ;
□ l'application de produit sur toute la face cachée de la plinthe après décollement de celle-ci.
Les lambris et boiseries
L'opération consiste à déposer les lambris ou boiseries afin de pulvériser leur face cachée. Il en est de même pour les pièces d'accrochage des lambris.
Cependant, si une dépose complète est impossible, le traitement doit être fait par injection de
produit en partie haute sur le dessus ou le dessous de la cimaise ou en partie basse des lambris
ou boiseries, au travers de trous alignés tous les 33 cm.